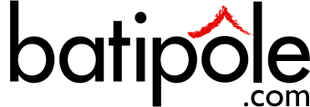« Bétonisation » L’UNICEM appelle à bannir un terme trompeur

Résumé pour les décideurs
Le terme « bétonisation », souvent utilisé pour désigner l'artificialisation des sols, amalgame à tort processus d'étalement urbain et matériau de construction. En réalité, le béton est un vecteur de durabilité et de solutions adaptées aux enjeux contemporains, permettant des constructions qui répondent aux exigences d'économie circulaire et de gestion raisonnée des ressources. Grâce à des formulations de plus en plus respectueuses de l'environnement, le béton contribue à des infrastructures résilientes, avec des surfaces perméables, des performances optimisées contre les aléas climatiques et une utilisation efficace des matériaux recyclés.
Dans le cadre d'une approche systémique pour un aménagement durable, il est crucial de dépasser les postures idéologiques. L'évaluation des projets doit s'appuyer sur des critères objectifs tels que l'analyse du cycle de vie et le bilan carbone. Opposer béton et écologie est une impasse; il est essentiel de privilégier des solutions constructives et contextualisées. Le béton se positionne ainsi comme un allié incontournable pour répondre aux besoins en logements, transport collectif et infrastructure publique, comme le souligne Alain Plantier, président de l'UNICEM.
Les syndicats professionnels réunis au sein de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM), dont le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE), interpellent les médias et les acteurs de l’aménagement, de la construction et des politiques publiques sur l’usage inapproprié et stigmatisant du terme « bétonisation ».
Un mot qui confond artificialisation et matériau
Ce mot-valise, sans base technique ni juridique, dessert la nécessaire transition écologique en opposant de manière simpliste urbanisation et nature.
Employé à tort comme synonyme d’artificialisation des sols, le mot « bétonisation » amalgame un processus d’étalement urbain avec un matériau de construction. Il occulte la réalité des usages : dans la majorité des cas, le béton est un vecteur de solutions, pas une cause de déséquilibres.
Le béton permet de construire durablement, de façon localisée et avec des formulations de moins en moins
carbonées, tout en intégrant les exigences croissantes d’économie circulaire et de gestion raisonnée des ressources.
Le béton, un levier d’adaptation et de résilience
Dans un contexte de dérèglement climatique, le béton apporte des solutions concrètes pour renforcer la résilience des infrastructures :
- Surfaces perméables et gestion intégrée des eaux pluviales,
- Ouvrages durables, conçus pour résister aux aléas climatiques extrêmes (inondations, fortes chaleurs, gel),
- Performances thermiques, acoustiques et énergétiques optimisées des bâtiments,
- Incombustibilité, résistance aux hautes températures et protection des structures porteuses en cas d’incendie,
- Utilisation de matériaux recyclés et valorisation des ressources locales,
- Conception compacte et efficace, limitant l’étalement urbain.
Le béton est également indispensable à la construction de logements accessibles, de réseaux de transport collectif, d’équipements publics et d’infrastructures essentielles à la vie collective.
Pour un débat technique, objectif et fondé
À l’heure où les enjeux d’aménagement durable nécessitent une approche systémique, l’UNICEM et le SNBPE appellent à sortir des postures idéologiques. L’évaluation des projets doit se faire sur des critères objectifs (analyse du cycle de vie, bilan carbone, multifonctionnalité des espaces, durabilité), et non à partir de concepts flous ou anxiogènes.
« Opposer béton et écologie est une impasse. Il faut parler de solutions constructives, contextualisées, et performantes. Le béton a toute sa place dans cette logique, en lien avec les autres matériaux », déclare Alain Plantier, président de l’UNICEM.